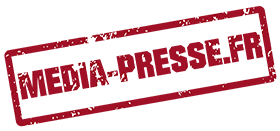Le devoir de diligence, est devenu une notion incontournable dans le monde des affaires. Au croisement entre la responsabilité sociale des entreprises (RSE), les droits humains et l’environnement, il engage les entreprises à prévenir les risques liés à leurs activités, y compris tout au long de leur chaîne de valeur. Si certains groupes en ont fait une priorité stratégique, d’autres se sont retrouvés sous le feu des projecteurs pour avoir failli à cette obligation. Zoom sur quelques cas emblématiques.
Le devoir de diligence : qu’est-ce que c’est ?
Le devoir de diligence désigne l’ensemble des mesures qu’une entreprise doit mettre en œuvre pour identifier, prévenir, atténuer et rendre compte des impacts négatifs de ses activités. Cela inclut notamment les atteintes aux droits humains, les risques environnementaux, ou encore les conditions de santé et sécurité au travail.
Depuis la loi française sur le devoir de vigilance (2017) et les évolutions du cadre réglementaire européen, cette obligation s’élargit à l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement : filiales, sous-traitants, fournisseurs, et partenaires commerciaux.
Comment le mettre en place concrètement ?
Mettre en œuvre une démarche de devoir de diligence efficace repose sur plusieurs étapes clés :
- Cartographier les risques : identifier les zones de vulnérabilité dans les activités et les chaînes d’approvisionnement.
- Dialoguer avec les parties prenantes : inclure les travailleurs, ONG, communautés locales.
- Élaborer un plan d’action clair, assorti de mesures concrètes de prévention et d’atténuation.
- Créer un mécanisme de plainte permettant aux personnes concernées de signaler les abus.
- Assurer la transparence : publier des rapports réguliers sur les actions entreprises.
Un plan de vigilance n’a de valeur que s’il est intégré à la gouvernance, mis à jour régulièrement, et suivi dans la durée.
TotalEnergies : vigilance insuffisante face aux enjeux environnementaux
En France, TotalEnergies fait face depuis 2019 à une action en justice initiée par des ONG. Elles accusent le groupe de ne pas respecter la loi sur le devoir de vigilance, notamment dans le cadre de son projet EACOP (East African Crude Oil Pipeline) en Ouganda et Tanzanie.
Les ONG dénoncent des atteintes environnementales, des expulsions forcées de populations locales, et des risques climatiques massifs. Selon elles, le plan de vigilance publié par Total est trop vague, incomplet, et insuffisamment appliqué. Ce cas montre les limites d’une approche perçue comme formelle plutôt que engagée.
Nike : la réputation entachée par les conditions de travail
Dans les années 90, Nike est devenu le symbole de l’échec du devoir de diligence. L’entreprise a été accusée d’exploiter des ouvriers dans des conditions dégradantes en Asie du Sud-Est : travail des enfants, salaires très bas, heures de travail excessives.
Face au scandale médiatique mondial, Nike a réagi en lançant des audits internes, des partenariats avec des ONG, et en publiant des rapports annuels sur sa chaîne d’approvisionnement. Ce revirement prouve que le devoir de diligence, bien que réactif au départ, peut devenir un levier stratégique pour améliorer les pratiques.
Nestlé : diligence ou gestion de crise ?
Autre cas souvent cité : celui de Nestlé, régulièrement pointé du doigt pour son approvisionnement en cacao en Côte d’Ivoire. Des enquêtes ont révélé l’usage de travail d’enfants dans certaines plantations.
Nestlé affirme mettre en place des programmes de traçabilité, soutenir les producteurs locaux et promouvoir le cacao durable. Toutefois, des critiques persistent : les efforts seraient encore insuffisants, et le système d’approvisionnement reste opaque. Cette situation interroge : agit-on par conviction ou par gestion de réputation ?
Conclusion
Ces cas illustrent une vérité centrale : un plan de vigilance ne doit pas être un simple exercice de conformité. Il doit être vivant, co-construit avec les parties prenantes, et proactif. Les entreprises doivent :
- Cartographier leurs risques réels ;
- Impliquer les acteurs concernés ;
- Rendre des comptes de manière transparente ;
- Et surtout, agir en amont des crises.
Avec l’arrivée prochaine de la directive européenne sur le devoir de diligence (CS3D), les entreprises devront démontrer leur engagement concret. À défaut, elles s’exposeront à des sanctions juridiques… et à une perte durable de confiance.